Accueil > Travaux et études > Réception de l’œuvre de Philippe Ariès > Elisabeth Badinter, "L’Amour en plus" (1980)
Elisabeth Badinter, "L’Amour en plus" (1980)
jeudi 1er juillet 2021, par
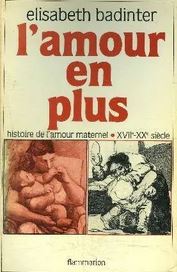
Elisabeth Badinter, L’Amour en plus : histoire de l’amour maternel (XVIIe au XXe siècle), Flammarion, 1980.
– Philosophe, spécialiste du XVIIIe siècle, influencée par les philosophes des Lumières dont elle a retracé l’histoire intellectuelle dans 3 volumes chez Fayard, Elisabeth Badinter est une figure emblématique du féminisme et une intellectuelle engagée sur la question de la laïcité. Elle est l’auteur de plusieurs ouvrages autour de la place des femmes dans la société comme L’Amour en plus, Madame du Châtelet, Madame d’Epinay ou l’Ambition féminine au XVIIIe siècle adapté à la télévision, Le conflit, la femme et la mère (2010) qui pose notamment la question de l’allaitement maternel et plus récemment, Les conflits d’une mère : Marie-Thérèse d’Autriche et ses enfants (2020).
– Issu d’un séminaire poursuivi pendant 2 ans à l’Ecole polytechnique, L’Amour en plus, ouvrage de vulgarisation de qualité, s’appuie alors sur les travaux récents des historiens comme, François Lebrun, Jean-Louis Flandrin, Maurice Garden, Edward Shorter dont Elisabeth Badinter cite abondamment Naissance de la famille moderne (1977) et Philippe Ariès pour l’Enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime.. La philosophe comme avant elle Ivan Illich utilise son modèle interprétatif de l’enfance.
– Sous titré « histoire de l’amour maternel XVIIe-XXe siècle », l’essai suscite de vivres critiques à cause de son analyse de l’instinct maternel décrit comme une construction sociale. Dans la préface à l’édition, en format poche, en 1981, ("Champs Flammarion", 1980), Elisabeth Badinter revient sur les réactions passionnées que ce livre a suscitées, tant selon elle, « la maternité est encore aujourd’hui un thème sacré » : « L’amour maternel est toujours difficilement questionnable et la mère reste, dans notre inconscient collectif, identifiée à Marie, symbole de l’indéfectible amour oblatif. »
– Elle répond également à certaines critiques de fonds sur sa principale thèse tout en récusant toute forme d’anachronisme : « Aux yeux d’un grand nombre, ne pas aimer son enfant est le crime inexpiable. Et quiconque tente de montrer que cet amour ne va pas de soi est immédiatement soupçonné de déraisonner, soit d’être l’accusateur injuste des femmes du passé, soit enfin d’interpréter propos et comportements en fonction des valeurs actuelles. »
Le projet d’E. Badinter (préface)

« L’histoire du comportement maternel des Françaises depuis quatre siècles n’est guère réconfortante. Elle montre non seulement une grande diversité d’attitudes et de qualité d’amour mais aussi de longues périodes de silence. Certains diront peut-être que propos et comportements ne dévoilent pas tout le fond du cœur et qu’il reste un indicible qui nous échappe. A ceux-là nous sommes tentés de répondre par le mot de Roger Vailland : « Il n’y a pas d’amour, il n’y a que des preuves d’amour. » Alors, quand les preuves se dérobent, pourquoi ne pas en tirer les conséquences ?
L’amour maternel n’est qu’un sentiment humain. Et comme tout sentiment, il est incertain, fragile et imparfait. Contrairement aux idées reçues, il n’est peut-être pas inscrit profondément dans la nature féminine. A observer l’évolution des attitudes maternelles, on constate que l’intérêt et le dévouement pour l’enfant se manifestent ou ne se manifestent pas. La tendresse existe ou n’existe pas. Les différentes façons d’exprimer l’amour maternel vont du plus au moins en passant par le rien, ou le presque rien.
Convaincus que la bonne mère est une réalité parmi d’autres, nous sommes partis à la recherche des différentes figures de la maternité, y compris celles que l’on refoule aujourd’hui, probablement parce qu’elles nous font peur. » (p. 10-11)
Extrait de "l’amour en plus" : dans les pas d’Ariès

« Pourquoi 1760 ? On peut être surpris de voir indiquer une date aussi précise au changement des mentalités. Comme si d’une année à l’autre tout avait changé. Tel n’est pas le cas, et Philippe Ariès a montré qu’une longue évolution fut nécessaire pour que s’ancre réellement le sentiment de l’enfance dans les mentalités. En étudiant très soigneusement l’iconographie, la pédagogie et les jeux des enfants, Ariès conclut que, dès le début du XVIIe, siècle, les adultes modifient leur conception de l’enfance et lui accordent une attention nouvelle qu’ils ne lui manifestaient pas auparavant. Mais cette attention portée à l’enfant ne signifie pas encore qu’on lui reconnaisse une place si privilégiée dans la famille qu’il en devienne le centre.
Ariès a pris soin de noter que la famille du XVIIe siècle, bien que différente de celle du Moyen Age, n’est pas encore ce qu’il appelle la famille moderne, caractérisée par la tendresse et l’intimité qui lient les parents aux enfants. Au XVIIe siècle, la société monarchiste n’a pas encore reconnu le règne de l’Enfant-Roi, coeur de l’univers familial. Or, c’est bien ce règne de l’enfant qui commence à être bruyamment célébré dans les classes montantes du XVIIIe siècle, aux alentours des années 1760-1770.
De cette époque date la parution d’une floraison d’ouvrages qui appellent les parents à de nouveaux sentiments et tout particulièrement la mère à l’amour maternel. Certes le médecin accoucheur Philippe Hecquet, dès 1708, Crousaz en 1722 et d’autres avaient déjà dressé la liste des devoirs d’une bonne mère. Mais ils ne furent pas entendus de leurs contemporains. C’est Rousseau, avec la publication de l’Emile en 1762, qui cristallise les idées nouvelles et donne le véritable coup d’envoi à la famille moderne, c’est-à-dire à la famille fondée sur l’amour maternel. On verra qu’après l’Emile, tous les penseurs de l’enfance reviendront durant deux siècles à la pensée rousseauiste pour en développer toujours plus loin les implications.
Avant cette date, l’idéologie familiale du XVIe siècle, en recul dans les classes dominantes, n’en finit pas de mourir partout ailleurs. Si l’on en croit non seulement la littérature, la philosophie et la théologie de l’époque, mais aussi les pratiques éducatives et les statistiques dont nous disposons aujourd’hui, nous constatons que, dans les faits, l’enfant compte peu dans la famille quand il ne constitue pas souvent une gêne réelle pour celle-ci. Au mieux, il a un statut insignifiant. Au pire, il fait peur. » (Extrait du chapitre II, “Le statut de l’enfant avant 1760” (p. 41-42))
 site dédié à Philippe Ariès
site dédié à Philippe Ariès