Accueil > Philippe Ariès dans son temps > Biographie > P. Ariès, "Saint-Pierre ou la douceur de vivre" (1981)
P. Ariès, "Saint-Pierre ou la douceur de vivre" (1981)
samedi 30 avril 2016, par

P. Ariès, "Saint-Pierre ou la douceur de vivre", dans Charles Daney, Catastrophe à la Martinique, (Herscher, "Archives de la Société de géographie", 1981, p. 11-24).
– Cette contribution de Philippe Ariès constitue l’introduction au volume de Charles Daney qui présente et légende les différents documents (photos prises juste après l’éruption de 1902) rassemblés par la Société de géographie. Ce bel ouvrage richement illustré (noir et blanc) comporte aussi le témoignage du docteur Émile Berté qui assiste depuis son navire ancré dans la baie à la catastrophe.
– Originaire de la Martinique, petit-fils d’un président de la Chambre de commerce de Saint-Pierre, Philippe Ariès évoque l’éruption de 1902 et son souvenir à partir de son expérience familiale également évoquée dans un Historien du dimanche (1980).
– Réédité par Roger Chartier, en 1993, dans Essais de mémoire. 1943-1983 (Seuil, coll. "L’univers historique"), le texte de P. Ariès fait l’objet d’une nouvelle édition commentée aux Publications de la Sorbonne (Paris I, Panthéon-Sorbonne) dans la collection "Tirés à part" dirigée par Philippe Artières qui invite à lire ou relire des textes de sciences sociales publiés au XXe siècle.
Début du texte de Philippe Ariès (p. 11-13)
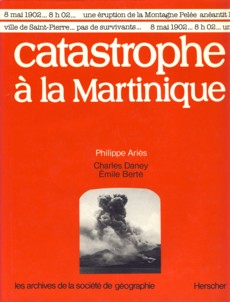
« Le 8 mai 1902, une ville de 30 000 habitants disparaissait dans un nuage de feu, en quelques minutes. Spectacle inouï, on compta les survivants sur les doigts d’une seule main. Il faudrait aujourd’hui aux automobilistes français deux bonnes années pour réaliser les mêmes performances. Toutes les conditions étaient réunies pour frapper l’imagination : la soudaineté, la rapidité, la violence, la totalité de la destruction. Une ville entière portée à très haute température et brûlée vive, une scène de science-fiction.
Or ce cataclysme spectaculaire a peu remué l’opinion mondiale, et française. A peine celle-ci a-t-elle donné quelques signes d’intérêt et de pitié comme une aumône. Le fait de cette différence est à lui seul surprenant. Un siècle et demi plus tôt, au milieu du 18e siècle, Lisbonne était détruite par un tremblement de terre qui faisait aussi 30 000 victimes. Tout le monde civilisé fut saisi d’horreur et d’une sorte d’angoisse philosophique. L’événement remit en question l’optimisme et l’assurance des hommes des Lumières, des philosophes, il força même Voltaire à réviser ses idées sur la Providence. Aujourd’hui, imaginons un événement comparable : les premières manifestations, les coulées de boue, les épaves du raz de marée apparaîtraient sur les écrans de télévision. Des envoyés spéciaux arriveraient sur les lieux (où étaient-ils, en 1902, les grands reporters ?). Des enquêteurs seraient dépêchés par le gouvernement : administrateurs, savants du Muséum, des universités ; Haroun Tazieff tonnerait sur les médias. Les journaux satiriques s’empareraient de l’événement, en dévoileraient les dessous politiques, d’autant plus volontiers qu’on serait en pleine période électorale — pour parfaire la ressemblance.
Qu’est-ce donc qui s’est passé dans l’intervalle d’un siècle ? Peut-être Saint-Pierre était-il trop loin des yeux, et les Antilles avaient- elles cessé de susciter les rêves et les envies, comme au temps de l’impératrice Joséphine et de la sultane Validée à la fin du 18e et au début du 20e siècle, leur plus belle époque. Quand le fait divers se passait en plein Paris, les réactions ne tardaient pas. Mais au fond des mers des Tropiques, à quinze jours de bateau ?
Pourtant, en 1902, les progrès des communications auraient pu compenser l’éloignement : c’était l’ère du télégramme. Quatre navires poseurs ou réparateurs de câbles croisaient autour de la Martinique et les meilleurs observateurs de la catastrophe étaient à leur bord. Les télégrammes officiels ou privés étaient nombreux, ils ont été recueillis et ils constituent l’une des meilleures sources de notre connaissance des événements. Quelques-uns, publiés en 1972 par le docteur Domergues, relevés par une écoute à moitié clandestine, restituent l’atmosphère. Et pourtant, si l’information a été plus rapide, elle s’est vite émoussée et elle n’a pas réussi à éveiller l’inquiétude, à émouvoir en profondeur. Elle s’est heurtée au mur de l’indifférence. On a l’impression que les informations heurtaient une volonté de ne pas se laisser troubler.
Serait-ce le signe avant-coureur de la mise à l’écart de la mort qui caractérisera le 20e siècle, mais plus tard, bien après la Première Guerre mondiale ?
Ne serait-ce pas plutôt (mais il y a sans doute un rapport) une manifestation du repli sur elles-mêmes des bourgeoisies qui inspirent les mœurs et les mentalités au 19e siècle ? L’une des leçons de l’événement de 1902 et de son faible impact, plus encore du refus de le « lire », de lui trouver un sens — comme au temps de Lisbonne ou de Hiroshima —, n’est-elle pas le signe de ce repli des sensibilités bourgeoises occidentales ?

Quand les catastrophes se passaient sous son nez, comme au temps déjà loin de l’incendie du bazar de la Charité, l’opinion réagissait encore. Mais dès que le théâtre du drame s’éloignait, elle devenait frileuse et détournait ses regards des fronts avancés qu’elle avait lancés, au 18e siècle et même auparavant. C’est aussi que les catastrophes naturelles ne l’intéressaient plus : les bourgeoisies dominantes refusaient ce sur quoi elles ne pouvaient pas agir. Aujourd’hui, si on ne peut éviter les séismes, on tente de les prévoir (par l’analyse statistique au Japon, à Lima, etc.) et on s’efforce d’en prévenir les effets. Une meilleure probabilité restitue à l’homme un certain pouvoir qui n’existait pas encore en 1902 — on se croyait alors dans le hasard absolu. Mais il est tout de même étrange que des phénomènes de ce genre aient si peu posé de problèmes aux hommes du temps. Les lecteurs de journaux du début du 20e siècle n’avaient pas la tête aussi philosophique que les lecteurs de Voltaire ou, auparavant, les auditeurs de Bossuet !
Ils n’étaient plus tentés de réfléchir sur les cataclysmes naturels : la nature avait perdu pour les hommes quelconques son pouvoir d’incitation ; c’est que les savants l’avaient sans doute monopolisée pour leur propre compte : elle n’était plus désormais accessible au vulgaire que sous la forme des techniques d’application.
C’est aussi que d’autres dangers apparaissaient à l’horizon : les guerres modernes, les guerres d’enfer. On en avait déjà l’expérience avec la guerre de Sécession, qui fut une répétition générale des grands massacres et des haines folles qui devaient emporter le siècle suivant dans leur tourbillon. On ne compterait plus désormais les morts par dizaines de milliers, chiffres dérisoires, mais par millions et même dizaines de millions. Les dernières guerres du 19e siècle, les guerres d’Italie, de Crimée, avaient déjà inquiété assez pour susciter la création de la Croix-Rouge, une sorte d’ordre laïque qui répondait aux interrogations de l’époque, comme les ordres mendiants au 13e siècle, les jésuites au 16e avaient répondu à celles de leur temps.
Si les 30 000 Pierrotins ont été vite oubliés par l’opinion, quelques-uns se sont souvenus et ont voué une sorte de culte à la ville perdue et à la vie qui l’avait animée : les survivants des familles créoles, c’est-à-dire blanches, ceux qui n’étaient pas à Saint-Pierre le 8 mai 1902, soit parce qu’ils avaient fui, soit qu’ils fussent par hasard ailleurs à la Martinique, soit qu’ils résidassent alors en France. C’était le cas de mes parents, de ma mère en particulier, dont les propres parents venaient tout juste de quitter la Martinique et de s’installer à Bordeaux ; de ma grand-mère paternelle (mon père et ma mère étaient cousins germains), qui vivait aussi à Bordeaux depuis la mort de son mari, survenue à Saint-Pierre, où il était président de la Chambre de commerce. Tous ceux-là vécurent dans une sorte de culte de la Martinique, dans la nostalgie de la vie à Saint-Pierre. J’ai été nourri de leurs récits merveilleux des Antilles, en ce bon vieux temps-là, enfoui à jamais sous les boues et les cendres du mont Pelée. »
 site dédié à Philippe Ariès
site dédié à Philippe Ariès

