Accueil > L’œuvre de Philippe Ariès > Les ouvrages de Philippe Ariès > L’homme devant la mort (1977)
Ariès, la mort, attitudes face à la mort
L’homme devant la mort (1977)
mardi 1er novembre 2011, par
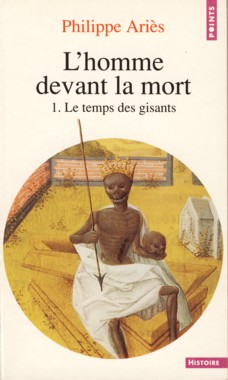
L’Homme devant la mort, Seuil, 1977, coll. "L’Univers historique" ; rééd. en poche dans la coll. "Points" histoire.
– Profitant de la dynamique créée par les Essais sur l’histoire de la mort en occident, opuscule qui rassemble les recherches d’une dizaine d’années, Philippe Ariès, porté par la logistique du Seuil, peut enfin se consacrer à la rédaction de son maître ouvrage L’Homme devant la mort.
D’autant que grâce à son ami, Orest Ranum, l’historien est admis, à Washington, pendant six mois au Woodrow Wilson International Center for Scholars, qui lui offre des conditions de travail privilégiées.
Le plan du livre
A la suite des thèmes introduits dans Essais sur l’histoire de la mort…, l’ouvrage est découpé en 4 parties : I) Nous mourrons tous, II) La mort de soi, III) La mort longue et proche et IV) La mort de toi.
La méthode
Fidèle à la méthode inaugurée pour les recherches de l’Enfant et la vie familiale…, l’historien ne s’interdit aucun type de sources et constitue ainsi un corpus documentaire varié : sources littéraires, liturgiques, testamentaires, épigraphiques et surtout iconographiques qui deviendront ensuite un bel album Images de l’homme devant la mort (1983). Ne pouvant prétendre à aucune forme d’exhaustivité compte tenu de la longueur de la période balayée, du Moyen Age à nos jours, il procède par sondages.
Le fil conducteur
Il existe une relation « entre l’attitude devant la mort et la conscience de soi, de son degré d’être, plus simplement de son individualité »
Un résumé d’après des extraits
S’installant dans la longue durée, Philippe Ariès prend comme point de départ, le premier Moyen Age, depuis la mort de Roland. Dans le chapitre « la mort apprivoisée », qui couvre la période entre le 5e et le 18e siècle, l’historien constate « la persistance pendant des millénaires d’une attitude presque inchangée devant la mort, qui traduisait une résignation naïve et spontanée au destin et à la nature ».
Cette mort apprivoisée coïncide avec le rapprochement des vivants et des morts quand les cimetières s’installent à proximité des villes et des campagnes dans la chrétienté latine.
Cependant, à partir du 12e siècle, l’iconographie médiévale révèle, dans un langage religieux, « les inquiétudes nouvelles de l’homme à la découverte de sa destinée ». Ainsi glisse-t-on, dans les représentations religieuses et dans les attitudes naturelles, « d’une mort conscience et condensation d’une vie, à une mort conscience et amour désespérée de cette vie ».
Cet individualisme nouveau dans le rapport à la vie et à l’au-delà détache l’homme de la résignation confiante et spontanée qui était jadis la sienne. Pour autant, explique l’historien, cette « mort de soi » n’est pas une rupture totale avec les habitudes anciennes comme en témoigne la pratique du testament : « Si, au travers des testaments, la mort est particularisée, personnalisée, si elle est aussi la mort de soi, elle reste toujours la mort immémoriale, en public, du gisant au lit. »
Conséquence de cette volonté d’être soi est la renonciation à l’anonymat des tombeaux qui tendent à devenir des monuments commémoratifs.

L’exacerbation de cette sensibilité qui exalte la mort et dont le paroxysme culmine, à la fin du Moyen Age, avec les arts macabres, connaît ensuite un reflux, à partir de la Renaissance jusqu’au 17e siècle.
Le moment même de la mort, dans la chambre et au lit perd de son importance relative. Le lien entre l’Eglise et le cimetière se relâche sans se rompre toutefois. Une évolution qui, dans la seconde moitié du 18e siècle se traduit par « une volonté de simplicité dans les choses de la mort » aboutissant enfin « à une sorte d’indifférence à la mort et aux morts ».
Parallèlement, d’après l’art, la littérature, et la médecine, la mort revient, sous la forme du corps mort, de l’érotisme macabre et de la violence naturelle : « On dirait que, dans son effort pour conquérir la nature et l’environnement, la société des hommes a abandonné ses vieilles défenses autour du sexe et de la mort ; et la nature, qu’on pouvait croire vaincue, a reflué dans l’homme, est entrée par les portes délaissées et l’a ensauvagé »
Dans ces conditions, le culte des cimetières et des tombeaux n’est que la manifestation liturgique de la sensibilité nouvelle, celle qui, à partir de la fin du 18e siècle, « rend intolérable la mort de l’autre ». Pour Philippe Ariès, à la fin du 20e siècle, ce sentiment dure toujours.
Enfin, ultime avatar de l’attitude face à la mort, « un type absolument nouveau de mourir est apparu au cours du 20e siècle, dans quelques-unes des zones les plus industrialisées ». C’est la mort inversée : « la société a expulsé la mort, sauf celle des hommes d’état. » La mort n’est plus un fait culturel qui structure la communauté. Cette relégation de la mort va de pair avec la médicalisation de la société.
Un extrait de la conclusion : « la démission de la communauté »
« Mais comment expliquer la démission de la communauté ? Bien plus, comment en est-elle venue à renverser son rôle et à interdire le deuil qu’elle avait mission de faire respecter jusqu’au XXe siècle ? C’est qu’elle se sentait de moins en moins impliquée dans la mort d’un de ses membres. D’abord parce qu’elle ne pensait plus nécessaire de se défendre contre une nature sauvage désormais abolie, humanisée une fois pour toutes par le progrès des techniques, médicales en particulier. Ensuite, elle n’avait plus un sens de solidarité suffisant, elle avait en effet abandonné la responsabilité et l’initiative de l’organisation de la vie collective ; au sens ancien du terme, elle n’existait plus, remplacée par un immense agglomérat d’individus atomisés. »
La mort dans Pages retrouvées (Cerf, 2020)

Pour prolonger cette réflexion passionnante sur la mort, retrouver dans Pages retrouvées, recueil d’articles inédits de Philippe Ariès, les contributions suivantes :
– La religion de la mort
– La liturgie ancienne des funérailles
 site dédié à Philippe Ariès
site dédié à Philippe Ariès